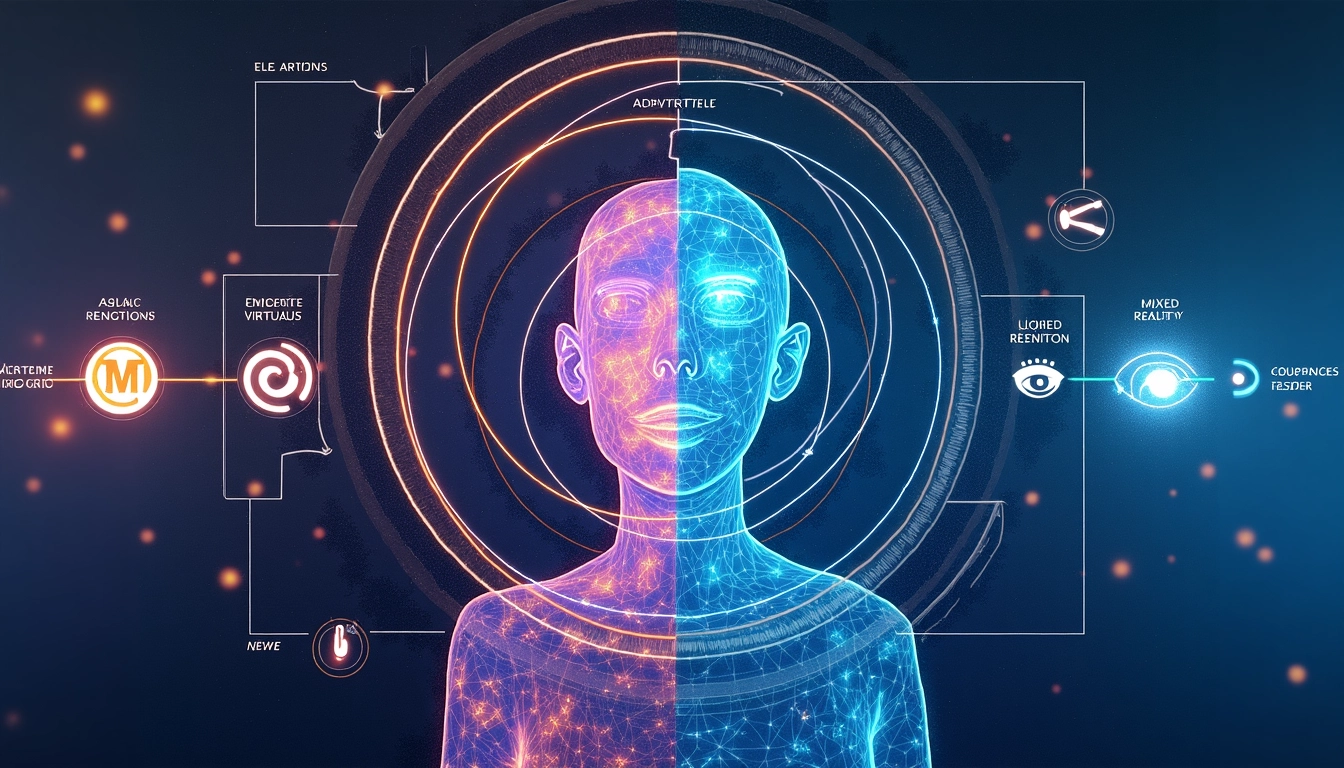La réalité étendue (XR) représente l’une des évolutions technologiques les plus fascinantes de notre époque. Ce terme englobe un ensemble de technologies immersives incluant la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte, transformant radicalement notre façon d’interagir avec le monde numérique. L’objectif fondamental de ces technologies est de créer une fusion entre notre environnement physique et un « monde jumeau numérique », permettant des interactions inédites entre ces deux dimensions. À l’heure où les frontières entre le réel et le virtuel s’estompent progressivement, la réalité étendue s’impose comme un vecteur d’innovation majeur dans de nombreux secteurs d’activité.
Cette technologie émergente ne se contente pas de révolutionner le divertissement, mais s’étend à des domaines aussi variés que la médecine, l’éducation, l’industrie et la formation professionnelle. Son potentiel transformateur réside dans sa capacité à créer des expériences multisensorielles de plus en plus réalistes, stimulant nos perceptions bien au-delà du simple visuel. Alors que les dispositifs deviennent plus accessibles et performants, la réalité étendue s’apprête à modifier profondément nos interactions quotidiennes avec la technologie.
Le concept de réalité étendue et son évolution technologique
Définition et principes fondamentaux de la Réalité Etendue
La réalité étendue, souvent désignée par le sigle XR (pour eXtended Reality), constitue un terme générique englobant trois principales technologies immersives : la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR) et la réalité mixte (MR). Cette appellation unifie ces différentes approches sous un même concept, reconnaissant leur objectif commun de modifier notre perception du monde qui nous entoure. L’essence de la XR réside dans sa capacité à créer un continuum entre le monde physique et numérique, permettant diverses formes d’interactions entre ces deux dimensions.
Le principe fondamental de la réalité étendue repose sur la création d’expériences immersives qui engagent l’utilisateur de manière plus profonde que les interfaces traditionnelles. Contrairement aux écrans conventionnels qui proposent une expérience passive, les technologies de réalité étendue placent l’utilisateur au centre de l’expérience, favorisant une interaction intuitive et naturelle avec le contenu numérique. Cette approche centrée sur l’humain transforme radicalement notre relation avec la technologie, en la rendant plus intuitive et immersive.
Les technologies de la réalité étendue se distinguent également par leur capacité à créer différents niveaux d’immersion, allant de la simple superposition d’éléments virtuels sur le monde réel jusqu’à la création d’environnements entièrement synthétiques. Cette flexibilité permet d’adapter l’expérience en fonction des besoins spécifiques de chaque application, qu’il s’agisse de former des professionnels, de concevoir des prototypes industriels ou simplement de divertir.
Historique et développement des technologies immersives
L’évolution des technologies immersives s’étend sur plusieurs décennies, avec des racines remontant aux années 1960. Le concept de réalité virtuelle a pris forme lorsque Ivan Sutherland a créé le premier casque à affichage tête haute en 1968, surnommé « l’Épée de Damoclès » en raison de son imposante structure suspendue. Cette innovation pionnière, bien que primitive, a posé les bases conceptuelles des dispositifs d’immersion modernes. Les décennies suivantes ont vu des avancées progressives, principalement dans des contextes militaires et de recherche, mais les limitations technologiques ont freiné leur adoption grand public.
Les années 2010 ont marqué un tournant décisif avec l’émergence de l’Oculus Rift, qui a catalysé un regain d’intérêt pour la réalité virtuelle en démontrant la possibilité de créer des expériences immersives à un coût accessible. Parallèlement, la réalité augmentée a connu une popularisation fulgurante grâce aux smartphones et applications comme Pokémon GO, qui a introduit cette technologie auprès du grand public. Ces développements ont convergé vers une reconnaissance de ces technologies complémentaires sous le terme unificateur de « réalité étendue ».
L’évolution récente de la réalité étendue a été caractérisée par une miniaturisation des dispositifs, une amélioration significative des performances et une réduction des coûts. Ces progrès, couplés à les avancées de la 6G et d’autres technologies complémentaires, ont permis d’éliminer progressivement les obstacles qui limitaient l’adoption massive de ces technologies. Aujourd’hui, nous assistons à l’émergence d’un écosystème XR mature, soutenu par des géants technologiques investissant massivement dans ce domaine, préfigurant une intégration de plus en plus profonde dans notre quotidien.
Le « monde jumeau numérique » : fusion entre réel et virtuel
Le concept de « monde jumeau numérique » représente l’aboutissement ultime des technologies de réalité étendue. Cette notion désigne la création d’une réplique numérique du monde physique, capable d’interagir avec ce dernier en temps réel. Cette fusion entre les dimensions physique et virtuelle permet de transcender les limitations de chaque environnement, créant de nouvelles possibilités d’interaction et d’expérience. Le monde jumeau numérique ne se contente pas de reproduire passivement la réalité, mais l’enrichit activement avec des informations contextuelles et des fonctionnalités interactives.
Dans cette perspective, la réalité étendue agit comme un pont entre ces deux mondes, permettant aux utilisateurs de naviguer fluidement entre différents niveaux de réalité. Cette hybridation offre des applications particulièrement puissantes dans des domaines comme l’urbanisme, où des architectes peuvent visualiser l’impact de nouveaux bâtiments dans leur contexte réel avant leur construction, ou dans l’industrie, où des jumeaux numériques de machines permettent d’optimiser les processus de maintenance et de production.
L’évolution de ce concept de monde jumeau numérique est étroitement liée aux progrès dans d’autres domaines technologiques, notamment l’Internet des Objets (IoT), l’intelligence artificielle et le edge computing . La convergence de ces technologies promet de renforcer encore davantage l’intégration entre les dimensions physique et virtuelle, ouvrant la voie à des expériences toujours plus riches et contextualisées. À terme, cette fusion pourrait redéfinir fondamentalement notre perception de la réalité et transformer radicalement nos interactions avec notre environnement.
Les différentes technologies de la réalité étendue
La réalité virtuelle (VR) : immersion totale dans un univers numérique
La réalité virtuelle représente la forme la plus immersive du spectre XR, transportant l’utilisateur dans un environnement entièrement numérique. Cette technologie se caractérise par son isolation complète du monde physique, permettant une immersion sensorielle profonde dans des univers synthétiques. À travers des casques spécialisés, la VR crée une illusion convaincante de présence dans un espace alternatif, stimulant principalement les sens visuel et auditif pour maintenir cette illusion. La puissance de la VR réside dans sa capacité à suspendre temporairement notre perception du monde réel pour nous plonger dans des expériences impossibles à vivre autrement.
Le principe fondamental de la VR repose sur la stéréoscopie, qui présente des images légèrement différentes à chaque œil pour reproduire la perception naturelle de profondeur. Cette technique, combinée au suivi des mouvements de la tête et parfois du corps entier, permet de créer une sensation convaincante de présence spatiale. L’effet d’immersion est renforcé par des systèmes audio spatialisés qui adaptent les sons en fonction de la position de l’utilisateur, complétant l’illusion d’un espace tridimensionnel cohérent.
La réalité virtuelle ne se contente pas de montrer un monde différent, elle vous fait croire que vous y êtes véritablement présent. Cette sensation de présence constitue la véritable révolution apportée par cette technologie.
Caractéristiques et fonctionnement des casques VR
Les casques de réalité virtuelle contemporains se divisent principalement en deux catégories : les dispositifs autonomes et ceux connectés à un ordinateur ou une console. Les casques autonomes, comme l’Oculus Quest, intègrent tous les composants nécessaires (processeur, mémoire, batterie) directement dans le dispositif, offrant une liberté de mouvement maximale. À l’inverse, les casques connectés comme le Valve Index ou le HTC Vive dépendent d’un ordinateur externe pour le traitement des données, permettant généralement des expériences visuellement plus riches au prix d’une mobilité réduite.
Techniquement, ces casques embarquent des écrans haute résolution (généralement entre 1440×1600 et 2160×2160 pixels par œil), un système de lentilles pour élargir le champ de vision, et divers capteurs de mouvement. Les systèmes de suivi spatial utilisent des technologies comme le « inside-out tracking » (caméras intégrées au casque) ou le « outside-in tracking » (capteurs externes) pour traduire précisément les mouvements physiques en actions virtuelles. Les contrôleurs manuels complètent l’expérience en permettant d’interagir avec les objets virtuels, parfois en intégrant des retours haptiques pour simuler des sensations tactiles.
L’évolution récente des casques VR témoigne d’efforts constants pour surmonter leurs limitations historiques : résolution accrue réduisant l’effet de « grille » visible, champ de vision élargi (passant d’environ 100° à plus de 120° sur les modèles haut de gamme), et systèmes de tracking plus précis. Ces améliorations, couplées à une réduction progressive du poids des dispositifs, contribuent à minimiser l’inconfort et les potentiels effets secondaires comme la nausée, historiquement associés à l’utilisation prolongée de la VR.
Applications actuelles de la réalité virtuelle
Si le jeu vidéo a initialement catalysé l’essor de la VR grand public, les applications de cette technologie s’étendent aujourd’hui bien au-delà du divertissement. Dans le secteur médical, la réalité virtuelle est employée pour former les chirurgiens, traiter les phobies par exposition progressive, et même comme alternative non-médicamenteuse à la gestion de la douleur. Des études cliniques démontrent que l’immersion VR peut réduire significativement la perception de la douleur lors de procédures médicales douloureuses, exploitant le phénomène d’attention limitée du cerveau humain.
Dans le domaine industriel, la VR révolutionne les processus de conception et de formation. Des constructeurs automobiles comme BMW et Volkswagen utilisent la réalité virtuelle pour évaluer l’ergonomie et l’esthétique des nouveaux modèles avant la production de prototypes physiques coûteux. Cette approche réduit considérablement les cycles de développement et permet d’identifier précocement les problèmes potentiels. Parallèlement, la formation en environnement virtuel permet de simuler des scénarios dangereux ou coûteux sans risque réel, particulièrement précieux dans des secteurs comme l’aérospatiale ou l’énergie nucléaire.
Le secteur de l’éducation explore également le potentiel pédagogique de la VR, transformant l’apprentissage abstrait en expériences concrètes. Des visites virtuelles de sites historiques aux simulations de phénomènes scientifiques complexes, cette technologie permet aux apprenants d’interagir directement avec les concepts étudiés. Cette dimension expérientielle améliore significativement la rétention des connaissances, particulièrement pour les apprenants visuels et kinesthésiques.
La réalité augmentée (AR) : superposition d’éléments virtuels au monde réel
Contrairement à la réalité virtuelle qui isole l’utilisateur dans un environnement entièrement synthétique, la réalité augmentée enrichit le monde physique en y superposant des éléments numériques. Cette technologie permet de conserver une perception directe de l’environnement réel tout en l’augmentant d’informations contextuelles ou d’objets virtuels. L’AR crée ainsi une expérience hybride où réel et virtuel coexistent et interagissent en temps réel. Son principe fondamental consiste à ancrer précisément les éléments numériques dans l’espace physique, créant l’illusion qu’ils font partie intégrante de notre environnement.
Pour fonctionner efficacement, les systèmes de réalité augmentée doivent accomplir trois tâches essentielles : la détection et le suivi de l’environnement (pour comprendre où placer les éléments virtuels), le rendu graphique (pour générer les objets numériques), et la superposition synchronisée de ces rendus sur la vue du monde réel. Cette superposition peut s’effectuer selon différentes méthodes, depuis la projection directe sur des surfaces jusqu’à l’affichage sur des écrans transparents positionnés devant les yeux de l’utilisateur.
L’un des avantages majeurs de l’AR par rapport à la VR réside dans son accessibilité et sa facilité d’intégration dans les activités quotidiennes. En ne remplaçant pas la réalité mais en l’enrichissant, l’AR permet une utilisation continue sans isolement social ou spatial, ouvrant la voie à des applications plus intégrées dans nos interactions quotidiennes. Cette caractéristique explique en partie pourquoi l’adoption de l’AR s’est développée plus rapidement dans certains secteurs professionnels et grand public.
Technologies mobiles et lunettes AR
La démocratisation de la réalité augmentée doit beaucoup aux smartphones, qui ont transformé un concept autrefois expérimental en technologie accessible à des milliards d’utilisateurs. Grâce à leurs caméras, capteurs de mouvement et capacités de traitement puissantes, les appareils mobiles modernes constituent des plateformes AR performantes sans nécessiter d’équipement supplémentaire. Des frameworks de développement comme ARKit d’Apple et ARCore de Google ont considérablement simplifié la création d’expériences AR, catalysant l’émergence d’innombrables applications dans des domaines aussi variés que le commerce, l’éducation ou les réseaux sociaux.
Parallèlement aux solutions mobiles, les lunettes de réalité augmentée représentent l’évolution naturelle de cette technologie vers des dispositifs dédiés et plus immersifs. Ces app areils AR représentent l’évolution naturelle de cette technologie vers des dispositifs dédiés et plus immersifs. Ces appareils portables comme les Microsoft HoloLens, Magic Leap ou les Nreal Light permettent une expérience AR mains libres, projetant des hologrammes numériques directement dans le champ de vision de l’utilisateur.
La grande différence avec l’approche mobile réside dans l’intégration transparente de ces éléments virtuels à notre perception naturelle, sans nécessiter de regarder à travers l’écran d’un smartphone. Ces lunettes embarquent des systèmes complexes incluant des caméras de profondeur, des unités de mesure inertielle et des processeurs dédiés pour cartographier l’environnement en temps réel.
Les défis techniques des lunettes AR restent considérables, notamment en termes de miniaturisation des composants, d’autonomie énergétique et de champ de vision. Les modèles actuels offrent généralement un angle de vision AR limité (entre 30° et 55° pour les dispositifs grand public), créant un effet de « fenêtre flottante » plutôt qu’une intégration complète dans le champ visuel humain naturel (qui s’étend à environ 210°). L’équilibre entre puissance de calcul, autonomie et confort de port constitue l’équation complexe que les fabricants s’efforcent de résoudre pour permettre une adoption massive de ces dispositifs.
Usages pratiques et divertissements en AR
La réalité augmentée a trouvé son premier succès commercial significatif dans le commerce et le marketing, où elle transforme l’expérience d’achat. Des applications comme celles d’IKEA ou Sephora permettent aux consommateurs de visualiser des produits dans leur environnement réel avant l’achat – un meuble dans son salon ou un maquillage sur son visage. Cette capacité de « try before you buy » virtuelle réduit significativement les incertitudes liées aux achats en ligne, diminuant les retours de produits tout en augmentant la satisfaction client. Les études montrent que les expériences d’achat intégrant l’AR peuvent augmenter les taux de conversion de 40% et réduire les retours de 30%.
Dans le domaine du divertissement, l’AR a connu une adoption fulgurante avec des applications comme Pokémon GO, qui a attiré plus de 500 millions d’utilisateurs en démontrant le potentiel ludique de cette technologie. Cette fusion entre jeu numérique et exploration du monde réel a créé un nouveau paradigme d’interaction sociale et physique. Dans le même esprit, des attractions touristiques et musées adoptent l’AR pour enrichir les visites, permettant aux visiteurs de voir des reconstructions historiques superposées aux ruines actuelles ou d’interagir avec des œuvres d’art de manière inédite.
Le secteur de la maintenance industrielle exploite également le potentiel pratique de l’AR pour améliorer l’efficacité opérationnelle. Des techniciens équipés de lunettes AR peuvent recevoir des instructions visuelles superposées directement sur les équipements qu’ils réparent, accéder à des manuels techniques en temps réel, ou bénéficier d’une assistance à distance d’experts pouvant voir exactement ce que le technicien voit sur le terrain. Boeing rapporte une réduction de 25% du temps de câblage et une diminution de 40% des erreurs grâce à l’utilisation de guides AR dans leurs processus d’assemblage.
La réalité mixte (MR) : interaction avancée entre virtuel et réel
La réalité mixte se positionne comme l’expression la plus sophistiquée du spectre XR, fusionnant les capacités de la réalité virtuelle et augmentée dans une expérience hybride où objets réels et virtuels coexistent et interagissent de manière cohérente. Contrairement à la simple superposition d’éléments virtuels de l’AR, la MR permet une intégration contextuelle intelligente où les objets numériques peuvent être occultés par des éléments physiques, interagir avec des surfaces réelles et répondre aux conditions environnementales comme l’éclairage. Cette compréhension spatiale avancée crée une illusion particulièrement convaincante d’intégration entre les deux mondes.
Techniquement, la MR requiert des capacités de traitement supérieures pour accomplir en temps réel la cartographie détaillée de l’environnement (spatial mapping), la reconnaissance d’objets, et la modélisation physique des interactions. Les dispositifs MR comme le Microsoft HoloLens 2 intègrent des caméras de profondeur, des capteurs infrarouges et des processeurs holographiques dédiés pour construire une représentation numérique précise de l’espace physique. Cette reconstruction en maillage 3D permet d’ancrer solidement les hologrammes dans l’environnement et de calculer leurs interactions avec celui-ci.
La réalité mixte ne se contente pas de montrer des objets virtuels dans le monde réel ; elle les fait véritablement exister dans cet espace, respectant ses contraintes physiques et interagissant avec ses éléments.
Les applications de la MR se distinguent par leur niveau d’intégration contextuelle. Dans le domaine médical, des systèmes MR permettent aux chirurgiens de visualiser des modèles anatomiques 3D superposés directement sur le patient pendant l’opération, tout en conservant l’accès aux informations vitales et aux outils chirurgicaux réels. Dans l’architecture et le design, la MR permet de placer des maquettes virtuelles dans des espaces physiques, offrant aux clients la possibilité de modifier en temps réel les matériaux ou configurations tout en se déplaçant naturellement autour du modèle comme s’il existait réellement.
Comparaison technique et expérientielle des technologies XR
Les trois principales technologies du spectre de réalité étendue peuvent être différenciées selon plusieurs critères techniques et expérientiels fondamentaux. En termes d’immersion, la VR offre l’expérience la plus intensive en isolant complètement l’utilisateur du monde réel, tandis que l’AR préserve entièrement la connexion avec l’environnement physique. La MR se situe à l’intersection, créant une fusion profonde mais sans isolation complète. Cette gradation d’immersion correspond également à des cas d’usage distincts : la VR excelle dans les expériences nécessitant une concentration totale ou l’accès à des environnements inaccessibles, tandis que l’AR et la MR brillent dans les situations nécessitant une conscience maintenue du contexte physique.
D’un point de vue technique, ces technologies présentent des exigences matérielles différentes. La VR requiert généralement les capacités de traitement graphique les plus importantes pour générer des environnements complets à haute fréquence d’images (90Hz minimum pour éviter les nausées), mais simplifie certains aspects en contrôlant entièrement l’environnement visuel. L’AR et la MR, en revanche, doivent traiter en temps réel le flux vidéo du monde réel, reconnaître les surfaces et objets, et intégrer harmonieusement les éléments virtuels – défis considérables en termes de latence et de précision spatiale.
Le tableau ci-dessous synthétise les différences clés entre ces technologies :
| Caractéristique | Réalité Virtuelle (VR) | Réalité Augmentée (AR) | Réalité Mixte (MR) |
|---|---|---|---|
| Niveau d’immersion | Totale (isolation du monde réel) | Partielle (superposition simple) | Hybride (intégration contextuelle) |
| Conscience environnementale | Absente ou très limitée | Maintenue entièrement | Maintenue avec intégration profonde |
| Dispositifs typiques | Casques occlusifs (Quest, Vive, Index) | Smartphones, lunettes transparentes | Casques semi-transparents, projecteurs avancés |
| Exigence de puissance | Élevée pour le rendu graphique | Modérée, adaptée aux mobiles | Très élevée pour le traitement spatial |
La réalité étendue multisensorielle : au-delà du visuel
L’intégration des cinq sens dans l’expérience de Réalité Etendue
Bien que la dimension visuelle domine actuellement les technologies XR, l’évolution vers une expérience véritablement immersive implique nécessairement l’intégration progressive des cinq sens. Cette approche multisensorielle vise à dépasser les limitations d’une immersion purement visuo-auditive pour créer des expériences plus complètes et convaincantes. Le cerveau humain interprète la réalité à travers une combinaison complexe de stimulus sensoriels ; ainsi, plus une expérience XR stimule de sens de manière cohérente, plus l’illusion de présence devient profonde et l’engagement cognitif intense.
L’ouïe constitue déjà un élément fondamental des expériences de réalité étendue actuelles, avec des systèmes audio spatialisés capables de positionner précisément les sons dans l’espace virtuel. Des technologies comme l’audio binaural et l’HRTF (Head-Related Transfer Function) reproduisent fidèlement la façon dont nos oreilles perçoivent naturellement les sons, créant une spatialisation réaliste qui renforce considérablement la sensation de présence. Ces avancées audio sont particulièrement déterminantes pour l’orientation spatiale et l’attention directionnelle dans les environnements virtuels.
Le toucher représente la prochaine frontière majeure de l’intégration sensorielle en XR, avec des recherches intensives visant à reproduire les sensations tactiles complexes qui enrichissent notre perception quotidienne. Au-delà du simple retour vibratoire, les technologies haptiques avancées cherchent à simuler la texture, la température, la pression et même la résistance des objets virtuels. Cette dimension tactile s’avère cruciale pour manipuler intuitivement des objets virtuels et pour renforcer le sentiment d’incarnation (embodiment) dans les expériences immersives.
Technologies haptiques et retours sensoriels
Les technologies haptiques évoluent rapidement pour dépasser les simples vibrations génériques et offrir des sensations tactiles nuancées et localisées. Les gants haptiques comme ceux développés par HaptX ou SenseGlove intègrent des microactuateurs pneumatiques ou électromécaniques capables de reproduire la sensation de toucher différentes textures et de ressentir la résistance d’objets solides virtuels. Ces dispositifs appliquent une pression variable sur différentes zones de la main pour simuler le contact avec diverses surfaces, permettant par exemple de distinguer le toucher d’une surface rugueuse d’une surface lisse ou de ressentir la différence entre presser un objet mou ou dur.
Au-delà des mains, des combinaisons haptiques comme le Teslasuit étendent cette expérience tactile à l’ensemble du corps. Équipées de dizaines ou centaines d’actuateurs répartis stratégiquement, ces combinaisons peuvent transmettre des sensations allant de la simple notification tactile jusqu’à la simulation de conditions environnementales comme la pluie ou le vent. Certains modèles avancés intègrent également des systèmes de bio-monitoring et de stimulation musculaire, permettant non seulement de ressentir l’environnement virtuel mais aussi d’y répondre de manière plus naturelle.
Le retour de force représente un aspect particulièrement complexe de l’haptique, visant à reproduire la résistance physique des objets. Des systèmes comme les exosquelettes haptiques et les dispositifs à suspension magnétique permettent de bloquer mécaniquement le mouvement de l’utilisateur pour simuler le contact avec des surfaces solides virtuelles. Cette technologie trouve des applications particulièrement pertinentes dans la formation professionnelle, permettant par exemple à un chirurgien en formation de ressentir la résistance spécifique des différents tissus lors d’une simulation d’opération.
Odorat et goût : les défis de la simulation sensorielle complète
L’intégration de l’odorat dans les expériences de Réalité Etendue représente un défi particulièrement complexe, malgré son importance fondamentale dans notre perception émotionnelle et mémorielle. Les systèmes olfactifs actuels reposent principalement sur des cartouches de composés chimiques volatils libérés avec précision par des diffuseurs contrôlés numériquement. Des dispositifs comme le FeelReal Mask ou les systèmes Olorama peuvent produire des dizaines d’odeurs différentes et les synchroniser avec les expériences visuelles. Ces technologies trouvent déjà des applications dans le marketing immersif, où l’odeur d’un plat ou d’un parfum peut être diffusée pendant sa visualisation en réalité augmentée.
La complexité des systèmes olfactifs réside dans la nature même de ce sens : contrairement aux ondes lumineuses ou sonores, les odeurs impliquent des molécules physiques qui doivent être stockées, libérées et dissipées. La création d’un « écran olfactif » capable de générer instantanément n’importe quelle odeur reste un objectif technologique ambitieux. Des recherches en cours explorent des méthodes alternatives comme la stimulation électrique directe des récepteurs olfactifs ou l’utilisation d’algorithmes permettant de recréer des sensations olfactives complexes à partir d’un nombre limité de composés chimiques fondamentaux.
La simulation gustative représente peut-être le défi le plus considérable du spectre sensoriel XR. Des chercheurs au National University of Singapore et au Meiji University au Japon développent des interfaces gustatives utilisant la stimulation électrique de la langue pour induire artificiellement des sensations basiques comme l’acidité, l’amertume ou le salé. D’autres approches explorent des combinaisons de stimuli thermiques, olfactifs et texturaux pour tromper le cerveau et créer l’illusion de goûter différents aliments. Ces technologies, encore largement expérimentales, pourraient révolutionner des domaines comme la gastronomie virtuelle ou la thérapie nutritionnelle.
L’ingénierie neuromorphique au service des expériences immersives
L’ingénierie neuromorphique, qui vise à créer des systèmes informatiques inspirés du fonctionnement du cerveau humain, ouvre des perspectives fascinantes pour l’évolution des technologies XR.